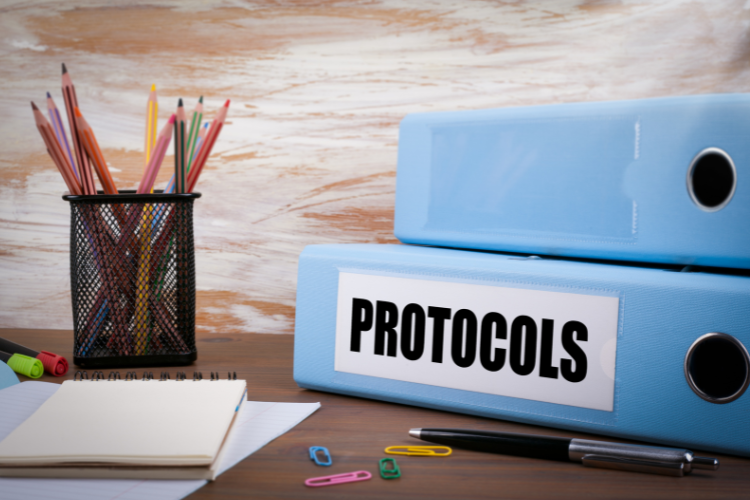Consultation du CSE : ce que vous devez savoir

« Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions » (article L2312-8 du Code du travail).
Au-delà de ce rôle de représentation, le CSE a une vocation essentielle : être informé et consulté par l’employeur sur les thèmes qui intéressent la vie de l’entreprise.
Comprendre les règles qui encadrent la consultation est indispensable, tant pour l’employeur qui doit respecter un formalisme précis (délais, procédure, traçabilité de l’avis rendu), que pour les élus qui souhaitent exercer leur mandat de manière efficace.
Dans cet article, nous définissons ce qu’est une consultation, ses modalités pratiques, les cas dans lesquels elle est obligatoire et les bonnes pratiques pour en faire un outil de communication au service du dialogue social dans l’entreprise.
Les règles exposées dans cet article s’appliquent uniquement dans les entreprises d’au moins 50 salariés.
Sommaire
Recevoir les
dernières actualités

Qu'est-ce qu'une consultation du CSE ?
La consultation du CSE est la procédure par laquelle l’employeur soumet un projet aux élus du comité social et économique afin de recueillir leur avis motivé. Concrètement, l’employeur présente le sujet à la délégation du personnel, qui doit ensuite se prononcer par un vote, généralement sous la forme d’un avis « favorable » ou « défavorable », éventuellement assorti de réserves ou d’explications.
Pour que le CSE puisse rendre un avis éclairé, l’employeur doit, au préalable, avoir fourni toutes les informations nécessaires et répondu aux éventuelles questions des élus.
La BDESE (base de données économiques, sociales et environnementales) est un élément essentiel de l’information du CSE. Elle doit être mise à jour avant toute consultation récurrente.
Dans certains cas, les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent demander une expertise qui sera réalisée par un tiers indépendant, rémunéré en partie par l’employeur.
Pour rendre leur avis, les membres de la délégation du personnel au CSE procèdent à un vote. La décision est prise à la majorité des membres présents. Les membres du CSE ne peuvent pas être sanctionnés s’ils refusent de rendre un avis dans le cadre d’une consultation.
L’avis du CSE est ensuite consigné dans le procès-verbal de séance et peut être communiqué aux salariés de l’entreprise ou à des tiers, lorsque la procédure le requiert.
À noter : l’avis du CSE est consultatif. L’employeur doit obligatoirement le solliciter, mais il n’est pas tenu de le suivre. Si l’employeur ne respecte pas ses obligations, le CSE peut saisir le tribunal pour délit d’entrave.
Exemple : en cas de rupture conventionnelle visant des salariés protégés, la consultation du CSE est obligatoire. Le comité peut entendre les explications des deux parties puis rend son avis. Cet avis doit être ensuite transmis à l’inspecteur du travail dans le cadre de la procédure d’autorisation.
Quel est le rôle du CSE ?
Le CSE doit rendre un avis motivé dès lors qu’il estime avoir reçu une information suffisante pour répondre à la question qui lui est posée.
Le comité peut formuler des propositions alternatives ou alerter l’employeur s’il estime que le projet objet de la consultation peut porter atteinte aux droits, à la santé ou à la sécurité des salariés ou altérer leurs conditions de travail.
Les différentes étapes de la procédure de consultation du CSE ?
Le processus d’information et de consultation du CSE a pour but de permettre à l’employeur de connaître l’avis des élus sur un projet qui concerne la vie de l’entreprise et ses salariés et, au travers de cet avis, de permettre aux salariés de l’entreprise de disposer d’informations sur les sujets qui les concernent. Ce processus repose donc sur une bonne information, une étude du projet, un dialogue entre l’employeur et les élus et la restitution d’un avis motivé.
L'information
L’employeur doit d’abord informer le CSE. Il fournit les explications et les documents nécessaires à la bonne compréhension du sujet. Ces informations doivent être complètes et sincères. Elles peuvent transiter par la BDESE.
L’étude du projet par le CSE
Une fois les informations reçues, le CSE étudie le projet. Il peut prendre des avis extérieurs et dans certains cas diligenter une expertise. Le recours à un expert (expert-comptable, expert habilité en santé, sécurité et conditions de travail, etc.) fait l’objet d’une résolution du CSE prise à la majorité des membres présents.
Les élus adressent leurs questions à l’employeur qui doit y répondre loyalement. Lorsque le comité comporte des commissions spécialisées (santé, formation, etc), le projet peut être d’abord analysé au sein de la commission concernée.
Les représentants du personnel peuvent formuler des observations et des contre-propositions.
À noter : les commissions suivantes doivent être mises en place dans les entreprises de 30 salariés et plus :
- la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT),
- la Commission de la formation
- la Commission d’information et d’aide au logement
- la Commission de l’égalité professionnelle
La Commission économique doit être mise en place dans les entreprises d’au moins 1000 salariés.
Le vote
Après débat, les membres du CSE rendent leur avis par un vote. La résolution est prise à la majorité simple des membres présents. Sauf dans de rares cas, le vote peut être organisé à main levée ou à bulletin secret. L’employeur ne participe pas au vote.
La rédaction du procès-verbal
L’avis est formalisé dans le procès-verbal de séance. Il est rédigé par le secrétaire du comité qui le transmet à l’employeur, celui-ci pouvant y inscrire ses observations.
Quel est l'objectif des consultations CSE ?
L’objectif des consultations est d’informer et d’associer les salariés (au travers du CSE) aux décisions de l’employeur lorsque celles-ci sont susceptibles d’affecter la gestion et la marche générale de l’entreprise ainsi que les conditions de travail et d’emploi.
Le but poursuivi par ces consultations est également d’obliger l’employeur à prendre l’avis du CSE avant la prise de décision.

Quelles sont les différentes consultations du CSE ?
Historiquement, le Code du travail contenait un certain nombre de dispositions, parfois dispersées dans différents chapitres, qui prévoyaient une obligation d’information et de consultation du CSE dans des cas précisément définis.
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise est venue compléter ces dispositions par trois consultations annuelles obligatoires (articles L2312-17 à L2312-36 du Code du travail).
Les dispositions antérieures n’ayant pas été supprimées, deux types de consultations coexistent aujourd’hui : les consultations dites “récurrentes” et les obligations dites “ponctuelles”.
Les consultations récurrentes du CSE
- Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise,
- Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi,
- Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise et leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences,
Un accord d’entreprise majoritaire au sens de l’article L2232-12 du Code du travail peut définir le contenu, la périodicité et les modalités de ces consultations.
Les consultations ponctuelles
Indépendamment des consultations récurrentes, l’employeur doit consulter le CSE dans un certain nombre de situations limitativement énumérées par le Code du travail :
- gestion et marche générale de l’entreprise (mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ou mesures en vue de faciliter le maintien au travail des accidentés du travail, mise en activité partielle, etc.),
- recours au CDD ou au travail temporaire (consultation sur les recours aux CDD en cas de départ définitif d’un salarié avant suppression de son poste, sur le programme de formation des travailleurs temporaires, etc.),
- durée du travail (consultation sur les modalités de fixation de la journée de solidarité, pour l’organisation des astreintes, le travail le dimanche, etc.),
- congés (consultation préalablement à un refus du congé pour création d’entreprise, d’un congé sabbatique, l’introduction de chèques vacances, etc.),
- plan d’actions (consultation sur l’établissement d’un plan pour l’égalité professionnelle, d’un plan sur la pénibilité, d’un plan d’amélioration de la sécurité),
- épargne salariale (consultation sur le livret d’épargne salariale, les modalités du PEE, l’assujettissement unilatéral à la participation, etc.),
- chartes et notes de service (consultation sur le règlement intérieur, la charte sur le droit à la déconnexion, la mise en place d’un dispositif d’alerte professionnelle, etc.),
- conditions d’hygiène, de sécurité et conditions de travail (consultation pour la mise en place d’un dispositif d’évaluation des salariés, l’entretien et nettoyage des locaux de travail, etc.).
Ces consultations ponctuelles doivent être réalisées avant toute décision définitive. À défaut, l’employeur commet un délit d’entrave.

Les impacts de la consultation CSE sur la prise de décision au sein de l'entreprise
Sauf dans des cas très spécifiques (voir plus haut), l’avis du CSE n’est pas contraignant.
Toutefois, les avis du CSE peuvent influencer l’employeur qui peut y trouver une source d’informations importante sur l’emploi, les salariés ou les effets de sa politique sociale.
Les avis du CSE peuvent également avoir un impact sur le climat social de l’entreprise. Ils peuvent être communiqués à l’ensemble des salariés. Un avis du CSE favorable peut donc permettre de renforcer la légitimité des décisions de l’employeur et aider à leur implémentation.
Les avis du CSE peuvent également influencer les tiers auxquels ils peuvent être transmis. Ce peut être par exemple l’inspecteur du travail qui devra donner son autorisation pour le licenciement des salariés protégés ou un juge qui devra apprécier le caractère réel et sérieux d’un licenciement collectif.
À quelle fréquence doit-on consulter le CSE ?
Pour les consultations récurrentes du CSE : une fois par an, sauf accord prévoyant une autre périodicité.
Pour les consultations ponctuelles du CSE : avant la prise de la décision définitive.

Comment préparer une réunion de consultation efficace ?
Pour que la consultation se déroule dans de bonnes conditions et permette un échange réellement constructif, certaines bonnes pratiques doivent être mises en place en amont de la réunion.
- Donner au CSE une information préalable, précise, complète et précise,
- S’assurer que la BDESE est à jour,
- S’accorder avec le secrétaire du CSE sur la formulation de l’ordre du jour,
- Pour des consultations d’ampleur : anticiper un calendrier avec les membres du CSE en incluant, le cas échéant, les commissions,
- S’y prendre à l’avance en anticipant les questions du CSE et les délais nécessaires à la conduite d’une expertise, lorsque cette possibilité est ouverte.

Laura Campion
Recevoir les
dernières actualités

Sommaire
Partager cet article